Les Asteraceae sont représentées dans la flore de notre région par les genres suivants : Achillea, Acroptilon, Aetheorhiza, Ambrosia, Anacyclus, Anaphalis, Andryala, Antennaria, Anthemis, Aposeris, Arctium, Arctotheca, Argyranthemum, Arnica, Arnoseris, Artemisia, Aster, Asteriscus, Atractylis, Baccharis, Bellis, Bellium, Berardia, Bidens, Bombycilaena, Buphthalmum, Cacalia, Calendula, Callistephus, Calycocorsus, Carduncellus, Carduus, Carlina, Carpesium, Carthamus, Catananche, Centaurea, Chamaemelum, Cheirolophus, Chiliadenus, Chondrilla, Chrysanthemoides, Chrysanthemum, Cicerbita, Cichorium, Cirsium, Cnicus, Coleostephus, Conyza, Coreopsis, Cosmos, Cotula, Crepis, Crupina, Cyclachaena, Cynara, Dahlia, Delairea, Dendranthema, Dimorphotheca, Dittrichia, Doronicum, Echinops, Eclipta, Erigeron, Eupatorium, Filago, Flaveria, Galactites, Galinsoga, Gamochaeta, Gazania, Geropogon, Gnaphalium, Guizotia, Hedypnois, Helenium, Helianthus, Helichrysum, Hieracium, Homogyne, Hyoseris, Hypochaeris, Inula, Jasonia, Jurinea, Lactuca, Lapsana, Leontodon, Leontopodium, Leucanthemella, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leuzea, Ligularia, Logfia, Lonas, Mantisalca, Matricaria, Mycelis, Nananthea, Nauplius, Notobasis, Olearia, Omalotheca, Onobroma, Onopordum, Osteospermum, Otanthus, Petasites, Phagnalon, Picnomon, Picris, Plagius, Podachaenium, Prenanthes, Pseudognaphalium, Ptilostemon, Pulicaria, Reichardia, Rhagadiolus, Rudbeckia, Santolina, Saussurea, Scolymus, Scorzonera, Senecio, Serratula, Sigesbeckia, Silphium, Silybum, Solidago, Soliva, Sonchus, Staehelina, Stemmacantha, Tagetes, Tanacetum, Taraxacum, Telekia, Tephroseris, Tolpis, Tragopogon, Tussilago, Tyrimnus, Urospermum, Verbesina, Xanthium, Xeranthemum, Zinnia.
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) fut un biologiste français connu pour sa Flore française dans laquelle était utilisée pour la première fois des clés analytiques permettant d’identifier les plantes classées selon un système naturel. Il est aussi connu pour sa théorie selon laquelle des variations du milieu induisent des modifications héréditaires des organes. 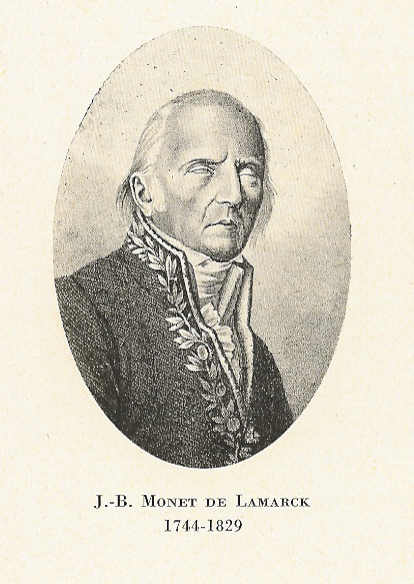
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
Sa théorie connue sous le nom de Lamarckisme se résume ainsi : – La génération spontanée. Les premiers êtres vivants se seraient formés par génération spontanée. – La modification des espèces sous l’action du milieu. Les êtres vivants, nés de manière spontanée, se perfectionnent avec le temps sous l’action du milieu. – L’hérédité des caractères acquis. Les transformations dues à l’action du milieu se transmettent aux générations suivantes s’ils sont communs aux deux sexes.
Michel Adanson (1727-1806)
Michel Adanson (1727-1806) fut un botaniste et un explorateur français des régions tropicales. Il passa six années au Sénégal à étudier la géographie, le climat et l’histoire naturelle de ce pays. De ce séjour, il publia l’Histoire Naturelle du Sénégal dans laquelle il substituait les systèmes anciens par un système naturel. De la même façon dans son Familles de Plantes, il groupa les plantes en classes selon leurs affinités. Une classe de cette époque se rapprochait plus de la notion actuelle d’ordre. 
Michel Adanson (1727-1806)
Joseph Pitton Tournefort (1628-1705)
Joseph Pitton Tournefort (1628-1708) créa une classification moins intéressante que celle de John Ray, son contemporain, car basée uniquement sur la forme de la corolle. En effet, John Ray (1628-1705), philosophe et naturaliste anglais, proposa un système de beaucoup plus avançé que celui de Linné. En effet, il fut le premier à reconnaître l’importance de l’embryon et de son nombre de cotylédons et à prendre en compte les caractères morphologiques des plantes. Pourtant, il maintint une classification en arbres, arbutes et ligneux. 
Joseph Pitton Tournefort (1628-1705)
Cependant, Joseph Pitton tournefort fut le premier à considérer les genres comme un rang taxonomique. Cependant, pour Tournefort, le genre et l’espèce étaient deux unités de rang égal. Beaucoup d’épithètes génériques données par Tournefort sont encore utilisées de nos jours : Salix, Populus, Fagus, Betula, Lathyrus, Acer, Verbena…
La famille de Jussieu
Antoine de Jussieu (1686-1758), Bernard de Jussieu (1699-1776) et Joseph de Jussieu (1704-1799) étaient les trois fils d’un pharmacien de Lyon qui se tournèrent vers la botanique. Le plus jeune, Joseph, partit en Amérique du Sud où il vécut de nombreuses années. Antoine succéda à Tournefort comme directeur du Jardin des plantes. Bernard fut son collaborateur. En 1759, ce dernier réorganisa le jardin du Trianon permettant une présentation des plantes prenant en compte le Fragmenta Methodi Naturalis de Linné mais aussi le Methodus Plantarum de Ray. La présentation de Bernard de Jussieu s’éloignait d’une part des classifications basées sur des caractères uniquement qualitatifs d’autre part de ceux sexuels de Linné, trop artificiels. Son système divisait les plantes à fleurs en Monocotylédones et Dicotylédones et prenait en compte la position de l’ovaire, la présence ou l’absence de pétales et leur soudure ou non. Cependant, il ne publia jamais sa classification. A partir de 1763, il fut accompagné dans son travail par son neveu Antoine Laurent de Jussieu. 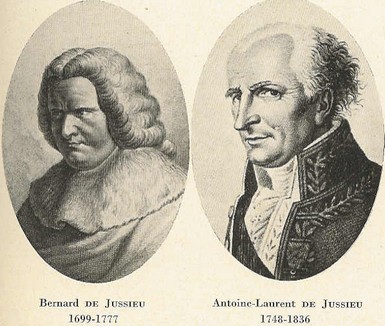 Antoine Laurent de Jussieu publia très rapidement, en 1773, une première étude intitulée Exposition d’un nouvel ordre des plantes dans lequel il améliorait le système de son oncle. Ce travail préliminaire se concrétisa en 1789 par le Genera Plantarum dans lequel il divisait les plantes en acotylédonées, en monocotylédonées et en dicotylédonées. Il prenait ensuite en compte le périanthe, présence ou absence de pétales, soudure ou non, ainsi que la position des étamines. Les plantes à fleurs étaient ainsi divisées en quinze classes (les ordres actuels) et en 100 ordres (les familles actuelles). De plus, apparaissaient pour la première fois, les notions d’étamines hypogynes, périgynes et épigynes qui sont encore en usage actuellement. Antoine Laurent de Jussieu fut le fondateur du Muséum national d’histoire naturelle. Son fils Adrien perpétua la tradition des Jussieu.
Antoine Laurent de Jussieu publia très rapidement, en 1773, une première étude intitulée Exposition d’un nouvel ordre des plantes dans lequel il améliorait le système de son oncle. Ce travail préliminaire se concrétisa en 1789 par le Genera Plantarum dans lequel il divisait les plantes en acotylédonées, en monocotylédonées et en dicotylédonées. Il prenait ensuite en compte le périanthe, présence ou absence de pétales, soudure ou non, ainsi que la position des étamines. Les plantes à fleurs étaient ainsi divisées en quinze classes (les ordres actuels) et en 100 ordres (les familles actuelles). De plus, apparaissaient pour la première fois, les notions d’étamines hypogynes, périgynes et épigynes qui sont encore en usage actuellement. Antoine Laurent de Jussieu fut le fondateur du Muséum national d’histoire naturelle. Son fils Adrien perpétua la tradition des Jussieu.
